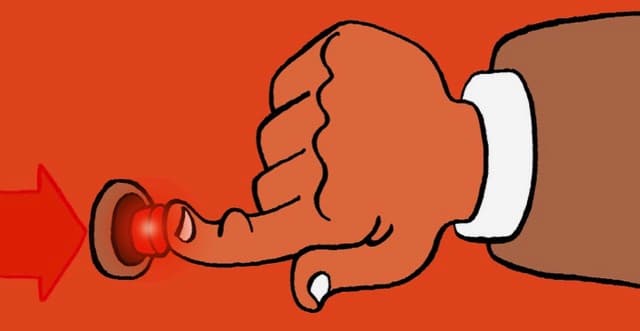Par Patrick Pascal, ancien ambassadeur et président du Groupe ALSTOM à Moscou pour la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie. Il est fondateur et président de « Perspectives Europe-Monde ».
Le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le 24 février, qui ne fut naturellement aucunement une célébration, a donné lieu à une prolifération plus grande encore de reportages et d’images au risque de saturer, de déprimer ou encore de démobiliser. Et pourtant, regarder, écouter, se sentir concerné, s’impose comme une nécessité en raison de la tragédie se déroulant à notre porte. La guerre qui a fait irruption sous nos yeux au XXIème siècle en Ukraine, c’est-à-dire en Europe, est bien réelle, alors que de précédents conflits périphériques d’une ampleur pourtant considérable, qu’il s’agisse du Sud-est asiatique, du Moyen-Orient, de l’Afrique et même des Balkans pourtant géographiquement proches de nous ne nous avaient pas concernés à ce point et demeuraient abstraits.
Il faut voir sans doute dans cette relative prise de distance d’alors un égoïsme passé, voire un autisme de nos sociétés de l’hémisphère nord alors qu’est ressenti aujourd’hui le sentiment, plus ou moins nettement exprimé, du risque d’engrenages possibles, voire d’une ascension à des extrêmes jusqu’ici inimaginables.
Dans la partie occidentale de l’Europe, s’était produit un assoupissement entretenu par l’idée que la construction de cette dernière avait apporté une paix durable entre anciens belligérants, alors que la communauté européenne, puis l’Union européenne, étaient aussi le résultat d’un état de paix. La sidération est un choc en retour et elle procède du constat selon lequel la guerre froide a disparu mais également les équilibres qui en étaient résultés. Le jeu des acteurs est perçu comme pouvant désormais échapper plus encore à une rationalité qui n’est déjà plus de mise depuis le premier jour de l’agression.
Les images de la guerre en Ukraine, démultipliées par les media et les réseaux sociaux, sont à dominante en noir et blanc car l’apocalypse n’est jamais en couleur. Elles nous montrent des immeubles éventrés par des obus et des missiles, des blindés en feu ou calcinés, des prisonniers hébétés qui ont parfois l’air d’adolescents et avaient été envoyés faire des « exercices » qualifiés ensuite « d’opération spéciale », des populations de tous âges fuyant sur des routes boueuses avec de maigres ballots pour échapper à l’enfer et même au pire. Non, il ne s’agit pas de documents d’archives mais d’une atroce réalité qui se prolonge.
Il est terrible de vivre cette tragédie et également pour ceux qui la contemplent à distance, d’être dans le même temps accablé d’un sentiment d’impuissance. Mais, sans voyeurisme aucun, il faut continuer à voir, entendre, essayer de comprendre. Nous ne sommes évidemment pas dans un jeu vidéo mais la violence dans l’histoire contemporaine s’est souvent réduite pour les opinions publiques, à l’écart du terrain, des affrontements et des souffrances indicibles, à des images, des sons et des « actualités filmées », comme l’on disait. Elle fut souvent une abstraction, destinée dans certaines situations à ménager des populations, les tranquilliser ou au contraire les entraîner. Y a-t-il donc un bon et un mauvais usage de la guerre en vidéo ?
Hiroshima mon Amour
Le premier jour de la guerre moderne en vidéo a peut-être été Hiroshima. Tout le monde connaît le champignon radioactif, auquel succéda celui de Nagasaki. Il s’agit le plus souvent d’une vue aérienne prise depuis l’avion chargé de la sinistre besogne ou d’un aéronef accompagnateur. L’explosion inconnue jusqu’alors ne fit pas de bruit à l’image, nous n’en ressentîmes pas le souffle dévastateur et encore moins le feu répandu au sol comme une faucille monstrueuse. L’avion s’appelait Enola Gay, du nom de la mère du pilote, et la bombe à l’uranium 235 Little boy. Une mère et un fils, comment est-il imaginable qu’ils aient pu être les symboles de la mort dans des proportions jusqu’alors inconnues ?
Etait-ce le prix pour arrêter l’avancée de Staline en Extrême-Orient, pour mettre un terme à une guerre du Pacifique qui aurait été interminable, îlot par îlot, et coûteuse en hommes ? Un Président, provincial, d’apparence terne, impopulaire, dont l’administration fut marquée par de nombreux scandales, entra dans l’histoire où il devint un acteur majeur de la guerre froide.
Le film d’Alain Resnais Hiroshima mon Amour, avec le scénario de Marguerite Duras, porte sur la mémoire et la réconciliation des peuples. « Tu n’as rien vu à Hiroshima », répète comme un leitmotiv l’amant japonais. En effet, ce ne sont pas les images qui comptent, y compris celle de l’épicentre toujours préservé, mais l’imprégnation des esprits. L’explosion n’est même plus identifiée, dans la conscience japonaise, à la puissance responsable, mais elle est jugée comme l’acte prométhéen suprême du feu dérobé aux Dieux, interdit jusqu’alors, commis par une humanité déterminée à anéantir la propre création qui la porte. Hiroshima, c’est nous tous.
Mais le Japon de la fin du second conflit mondial ne se réduit pas à Hiroshima et Nagasaki. Qui se souvient des bombardements de Tokyo, à partir de 1944 et jusqu’en juin 1945 ? Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, alors que le Japon le jour même, dans une fuite en avant, opérait son coup de force en Indochine pour y éliminer l’administration française, des bombes incendiaires provoquaient des ravages plus importants que l’explosion atomique de Nagasaki, cinq mois plus tard. Ce fut le plus meurtrier bombardement de la seconde guerre mondiale qui dépassa en nombre de victimes celui de Hambourg en juillet 1943 ou de Dresde en 1945. J’ai connu un Français qui était prisonnier à Dresde à ce moment-là, condamné au travail obligatoire (STO). Il participa volontairement, comme il le put, aux efforts pour éteindre les gigantesques incendies et secourir les survivants. Des années plus tard, il retrouva à Paris une famille allemande qu’il avait sauvée et était à sa recherche.
Napalm Girl et l’Amant
C’est ensuite le Vietnam, après la guerre d’Indochine, qui nous vient à l’esprit. Là encore la guerre fut, dans un premier temps tout au moins, aérienne, distanciée, jusqu’à ce que les medias – accompagnant un corps expéditionnaire qui avait changé de dimension et atteint son apogée avec le Président Johnson – n’en fassent le conflit le plus médiatisé du monde. Il faut revoir dans Heart and Minds, fait d’actualités filmées, cette séquence montrant le général Westmoreland, commandant en chef, s’exprimant sur place avant 1968 dans son uniforme blanc immaculé et décrivant des Vietnamiens que les bombes écrasaient comme des moustiques. On pouvait les éliminer puisqu’ils n’étaient pas tout à fait des être humains, n’est-ce pas ? Mais au sol, personne n’a oublié le cliché Napalm girl de 1972 du photographe Nick Ut montrant une petite fille vietnamienne brûlée et errant sur une route. Cette photographie marqua l’opinion mondiale et contribua sans doute à ce que soit mis un terme à la guerre du Vietnam.
J’étais au Vietnam en 1974, entre les Accords de Paris du début de janvier 1973 et la chute de Saïgon en avril 1975. Une étrange transition, faite d’une paix imparfaite et d’une guerre non achevée, allait être bousculée par la réunification du pays. Dans le centre du Vietnam, je logeais face à la sublime baie de Nha Trang, dans un hôtel appelé La Frégate tenu par un ancien « colonial », venu en 1945 avec le corps expéditionnaire du maréchal Leclerc pour rétablir la présence française, qui était resté après avoir épousé une femme autochtone. L’établissement était le quartier général des conseillers militaires américains opérant dans la zone de Danang qui rentraient le soir de leurs opérations dans une ambiance d’Apocalypse now.
Dans la province de Vinh Long du delta du Mékong, théâtre de L’Amant de Marguerite Duras, « le jour (continuait à être) aux forces gouvernementales et la nuit aux Viets », comme l’on disait à l’époque française. Dans les rizières, en cette période de mousson, l’on pouvait croiser des Vietcongs habillés de noir avec un grand chapeau conique, discrets, isolés et se livrant à des opérations de surveillance. La nuit retentissait des sourds tirs de barrage de l’armée régulière sud-vietnamienne, dont les cibles n’étaient pas aisément identifiables. Telle était la réalité du terrain, d’une guerre se poursuivant dans la paix et qu’il paraissait si difficile d’interrompre.
Chacun a en tête les images de la chute de Saïgon, mais nous souvenons-nous de celle de Pnom Penh ? Et plus encore, pouvons-nous visualiser ce qui s’en est suivi, la terreur Khmer rouge et le quasi anéantissement d’une nation ? Avons-nous aussi approfondi le sujet et nous sommes-nous demandé si des années de bombardement de la fameuse « piste Ho Chi Minh », de défoliations et de déforestation – dont nous n’avons pratiquement pas d’image – n’ont pas aussi contribué à produire cette violence insensée ? Il est vrai que William Shawcross a écrit sur le sujet un livre qui résume bien les choses et dont le titre français est Une tragédie sans importance.
Cercueils en zinc
Les Soviétiques ont soigneusement dissimulé, autant qu’ils le pouvaient, la réalité de terrain de leur intervention en Afghanistan, à partir de 1979, pour une guerre de dix ans. Mais ce sont les cercueils rapatriés en Russie et les mères de soldats qui ont puissamment contribué à faire basculer le conflit. La blessure n’est probablement toujours pas refermée et Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature, Biélorusse de mère ukrainienne, a consacré en 1990 à cette épreuve Cercueils de zinc, un ouvrage-enquête. Il en est de même de la guerre interne, cette fois-ci en Tchétchénie, où des sommets de l’horreur ont été atteints.
J’étais en Afghanistan en 1996, alors que les combats faisaient rage autour de Kaboul qui allaient se terminer par la première prise de pouvoir par les Talibans. A Mazar-e-Charif, encore contrôlée par le seigneur de la guerre Dostom, régnait encore une fausse paix. Les programmes des Nations Unies se poursuivaient au profit des minorités, tels les chiites Hazara ou des enfants dont s’occupaient l’UNICEF et le PNUD. Des ONG se consacraient à de nombreuses actions en faveur du développement. Que sont devenus ces humanitaires et leurs bénéficiaires sous la férule des Talibans ?
L’accouchement de la fin de l’histoire
La période d’euphorie factice, qui a accompagné ce que l’on a appelé la « Fin de l’Histoire » due à la disparition de l’Union soviétique – annoncée à grands renforts de tambours et trompettes par de savants politologues -, s’est accompagnée de grands changements technologiques, notamment dans le domaine des armements.
La guerre du Golfe de 1991 a ainsi été présentée à l’opinion mondiale comme devant être un conflit faisant appel du côté de la coalition anti-Saddam Hussein à des moyens technologiques sans précédent et, dans ces conditions, comme une opération « zéro mort ». Le soir du 16 janvier 1991, je me trouvais dans la salle de consultations du Conseil de sécurité à New York, attenante à la pièce connue où se déroulent les séances publiques. Lorsque le conflit débuta et que la nuit de Bagdad s’embrasa, délégués et fonctionnaires des Nations Unies se rassemblèrent devant un poste de télévision. Le ciel était vert parsemé d’éclairs, le spectacle était presque beau et suscitait une excitation à la mesure de la longue période de tension qui avait précédé la riposte depuis l’invasion du Koweït au mois d’août de l’année précédente. Nous étions totalement dans le jeu vidéo qui avait été proposé à l’opinion publique mondiale.
La réalité est qu’il n’y eut qu’un nombre très faible de victimes du côté de la coalition (NB: mais où étaient donc les armes de destruction massive de Saddam Hussein ?). En revanche, le côté irakien eut à subir un tapis de bombes digne de la seconde guerre mondiale. Ce fut à l’échelle de Dresde, de Berlin ou de l’incendie de Tokyo du 9 mars 1945, suite à des bombardements. Nous n’eûmes pas droit à des images prises au sol.
Au beau milieu de cette première guerre du Golfe, qui ne dura que quelques semaines, se produisit une incident majeur très médiatisé. Des caciques du régime baasiste irakien s’étaient réfugiés avec leurs familles dans un bunker dont un bombe américaine, d’un type particulier, perça les mètres de béton de protection avant d’exploser à l’intérieur. Il est inutile de décrire la suite qui fut naturellement exploitée par Saddam Hussein mais le choc fut tel pour l’opinion, par rapport à l’annonce « zéro mort », que le Président George Bush Sr., lui-même visiblement affecté, fut sur le point de mettre un terme à l’opération militaire.
Du bon usage de la vidéo
On ne peut égrener la litanie de tous les conflits de la planète, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Mais le pire est sans doute la méconnaissance. Quelle représentation avons-nous de la « guerre des marais » entre l’Iran et l’Irak, sorte de guerre des tranchées de 1914 au Moyen-Orient, de la guerre au Yémen et même de celle se déroulant encore en Syrie ? Et il faut naturellement en revenir à l’Ukraine.
Il est nécessaire que nous disposions du maximum d’informations sur ce qui se passe en Ukraine. Les témoignages des réfugiés, le rôle des journalistes, la résistance filmée et photographiée de la population, l’enregistrement des violations du droit humanitaire et d’une manière plus générale des exactions commises, permettront de rendre les responsables, quels qu’ils soient, comptables de leurs actes.
Les concepteurs de l’invasion auront d’une certaine manière joué à un jeu vidéo. Outre qu’ils ont été aveuglés par des schémas mentaux d’un autre âge, ils se sont illusionnés sur leur armée, qu’ils ont cru modernisée et irrésistible. Quelle que soit l’issue militaire, nous en voyons bien les faiblesses, qu’il s’agisse des équipements, de la tactique et de la maîtrise opérationnelle, sans parler du moral des troupes engagées initialement parfois sans le savoir dans une vraie guerre, sans légitimité autre qu’un discours mensonger et grotesque sur « le génocide et le néo-nazisme », face à des populations défendant leur terre.
Les vidéos des guerres sont ambivalentes: elles peuvent servir celles-ci , mais aussi à les dénoncer. La longue litanie des guerre ne conduit ainsi pas nécessairement au renoncement, à l’affaiblissement de l’esprit de défense et à un pacifisme qui peut s’avérer hors de circonstances.
L’effondrement de la France en 1940 a résulté d’une telle mentalité conduisant à « l’apaisement » par tous les moyens, outre la division du pays et une dénatalité émolliente. La première condition de la liberté est la sécurité et l’heure est donc au soutien à la résistance et à l’aide humanitaire aux populations affectées. Cette totale fermeté requiert également, alors que l’agresseur a recouru à plusieurs reprises à un langage relevant de la dissuasion nucléaire, le maintien minimal de canaux de communication et aussi la détermination à promouvoir la diplomatie lorsque celle-ci sera possible et appropriée.
Patrick Pascal
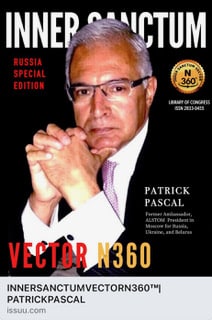
Patrick PASCAL est publié aux Etats-Unis par la Revue INNER SANCTUM VECTOR N360 (Dr. Linda RESTREPO Editor/Publisher) qui vient de lui consacrer une Edition spéciale sur la Russie
→ https://issuu.com/progessionalglobaloutreach.com/docs/patrickspecialedition
Patrick Pascal est également l’auteur de Journal d’Ukraine et de Russie (VA Éditions)
Disponible auprès de VA-EDITIONS.FR